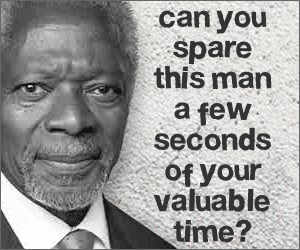Je le regardais toujours avec des yeux écarquillés, depuis petit, il était mon idole, je le trouvai tellement fort.
Il était plus âgé de six ans, je l'avais surnommé « Nono », en référence au personnage d'un dessin animé que je regardais à la télé!
Je me souviens des matins, sur le chemin de mon école, il m'accompagnait, et veillait à ce que je rentre bien derrière les grilles; à la fin de la journée, très souvent, je voyais encore sa silhouette, appuyé contre un arbre, il m'attendait. Plus tard, une fois rentré chez nous, il me mettait à la table de la salle à manger, il ouvrait mon cartable, posait devant moi tout son contenu, et invariablement me disait la même phrase : « Travaille, y'a pas ! ».
Les soirs d'hiver, ma mère allumait la lumière en m'apportant un chocolat chaud, tout fumant et deux tartines de pain.
Aujourd'hui encore, mais déjà à cette époque, ma mère se faisait du souci pour nous; elle travaillait la nuit dans un hôpital, ce n'était pas simple. J'ai toujours pensé que ma mère ne dormait pas; je ne la voyais jamais aller se coucher, dans mon imagination d'enfant, elle était tout à la fois Batman et Superman. Depuis le départ de mon père, elle avait la charge de deux garçons, de notre appartement et de son boulot. Je ne lui voyais aucune occupation, aucun hobby, à part quelques voisines, elle ne semblait pas avoir d'amies et que je sache, elle ne sortait jamais sans nous.
Une fois, je l'avais surprise, elle parlait avec la mère de Sabrina. Elle lui racontait qu'elle voyait le temps s'enfuir, toujours un peu plus, depuis le départ de son mari; elle disait sa profonde tristesse, combien elle s'était sentie trahie et même qu'elle ne pourrait plus jamais faire confiance; une phrase, en particulier, m'a marqué à tout jamais : « C'est horrible, quand j'y pense, mais depuis que Pierre m'a quitté, j'ai arrêté d'être une femme, je ne suis plus qu'une mère! »
Elle était aide soignante, travaillait donc, de nuit, et notre père était parti quand j'avais 6 ans.
Il travaillait sur le port, pour un grand transporteur maritime. Norbert m'a expliqué que c'était le boulot de nuit, de notre mère, qui avait fini par tuer leur couple. Moi je ne voyais qu'une chose, ma mère était là, chaque fois qu'il le fallait pendant la journée. C'est aussi pour cette raison qu'elle avait choisi, puis gardé, ces horaires, et aussi parce qu'elle était mieux payée. Pourtant sa plus grande trahison, ne fût pas de quitter ma mère, pour une de ses amies, mais plutôt d'avoir divorcer de Norbert et moi.
Après leur divorce, il revînt nous chercher quelques fois, nous allions au Rôve, dans les calanques, ou au parc Borrelli; là, ils nous achetait une glace, nous faisions de la voiturette vélo. Même Norbert, plus âgé, plus conscient et qui vivait plus mal que moi cette séparation parentale, appréciait pourtant visiblement ces moments; je cois pouvoir dire que nous passions, avec notre père, des instants comme jamais, même du temps où nos parents étaient encore mariés.
Puis, une après-midi que nous étions au bord de l'étang du parc, à jeter du pain aux canards, il nous annonçât que Nicole, sa compagne, était enceinte. Encore une fois, j'accueillais bien mieux la nouvelle que Norbert; il nous assura que cela ne changerait rien entre nous, qu'il continuerait à nous voir et que c'était même un heureux évènement, nous allions avoir un petit frère ou une petite soeur.
Depuis le divorce, nous n'avions plus vu Nicole, ma mère s'opposait, violemment, à ce que cette pou... souille aussi ses fils. Mon père avait une seconde vie, qui m'était totalement inconnue, je n'avais aucun moyen de l'imaginer chez lui, mais je n'en disais rien, pour ne pas faire souffrir ma mère.
Pendant les mois de la grossesse, nous le vîmes un peu moins; je pensais, c'est normal, il doit être auprès de la femme qu'il aime, il doit la soutenir. Norbert, lui, commençait à être de plus en plus aigri, vis à vis de notre père. Il me tenait des discours auxquels je n'entendais rien; il y était question de se protéger, de ne pas se faire d'illusion, etc...
Vînt le moment de l'accouchement, ma mère pleurait tous les jours. Elle s'imaginait que nous ne le savions pas, mais il y a des choses que les parents ne peuvent cacher à leurs enfants.
Sans que je sache pourquoi, et apprenant durement, le sens des propos de mon frère, je dus me résoudre : il y avait, maintenant 2 mois de passés depuis l'accouchement, et je ne savais même pas si j'avais un frère ou une soeur. Plus une seule nouvelle, Norbert refusait de faire un pas, pour ma part j'en avais gros sur le coeur; ce fût ma mère qui se dévoua pour lui téléphoner. Il fallut bien se rendre à l'évidence, le disque au bout du fil, nous apprenait que le correspondant avait changé de numéro! Stupéfaction, la pension, même celle du mois dernier, était toujours virée, nous n'avions rien vu, rien pu voir, venir. Il avait déménagé, il nous fallût accepté ce fait! Nous finîmes par apprendre qu'il était installé au Havre.
De notre père, il ne fût plus jamais question entre nous trois; absent de nos conversations, je sais qu'il occupait une partie au moins de nos pensées et que son départ influait sur nos actes, nos décisions, même si nous n'étions pas conscients de cela.
J'avais six ans, Norbert douze, il se mît en tête de devenir la présence masculine de la famille. Ainsi, il suivait ma scolarité, à sa façon, et négligeât sa vie. Ma mère, comme elle le confiât beaucoup plus tard à son amie, devînt mère avant tout et contre tout, y compris sa propre existence.
Au début de cette situation nouvelle, désemparée et empêtrée dans son malheur, elle me laissait sous la responsabilité de Norbert, la nuit quand elle partait travailler; bien sûr, il avait l'ordre de grimper deux étages, pour aller frapper à la porte de Carole, la mère de Sabrina, si quoi que ce soit arrivât. Invariablement, nous finissions par monter manger chez Carole; elle était ainsi plus tranquille. Après les repas, je passais des heures à jouer avec Sabrina, dans sa chambre. Nous étions dans la même classe de la même école, nous habitions dans le même immeuble et nos mères étaient amies, je ne sais pas si le destin existe ou si nos routes sont prédéterminées, ici, les chemins se croisaient très souvent. Quelquefois, Norbert était venu avec nous, mais sans doute à cause de nos jeux puérils pour lui, il finît rapidement par redescendre chez nous. Je pouvais rester jusqu'à neuf heures.
Sabrina était un peu garçon manqué, et moi, moins brute que les autres petits garçons, il faut croire que c'est ce qui nous a soudé. Nous avons grandi l'un à côté de l'autre, nous avions chacun deux chez nous et il suffisait d 'en trouver un pour dénicher l'autre. Certains matins, je devais monter deux étages pour retrouver certaines de mes affaires disparues; nos vies étaient éparpillées dans les deux appartements de nos mères.
Quatre années étaient passées, et ce fût un tournant; Norbert avait seize ans, il décidât d'arrêter l'école, avec l'accord de notre mère, il entrât en apprentissage, chez un garagiste. Je n'avais rien vu venir, je ne voyais pas ce qu'était sa vie, il était mon grand frère, fort et j'étais trop jeune pour sentir son mal être. Notre mère ne s'était pas opposé à sa volonté, car il collectionnait les mises à pieds et les carnets de notes exécrables. Ensemble, ils firent les démarches pour trouver un employeur, un collège d'enseignement technique, fournir tous les documents nécessaires et valider son engagement dans cette voie. Il allait au collège une semaine sur deux, pour l'enseignement théorique et général, simplifié par ailleurs, et l'autre semaine chez son employeur pour la formation pratique. Cela semblait lui convenir, et quoi qu'il en soit exactement, il était assidu aux deux parties de son enseignement.
Pour ma part, j'entrais au collège, en sixième, Sabrina, Rachid, Marco et David aussi. C'en était terminé de nos tranquilles balades pour aller ou revenir de la petite école du quartier; le matin nous prenions un bus, il faisait encore nuit, de nouvelles personnes entraient dans nos vies, un autre monde frappait à nos portes. Nous squattions la banquette du fond, j'étais toujours à côté de Sabrina. La répartition dans les différentes sixièmes nous avait séparé, exception faite de Sabrina et moi; ils nous avaient laissé ensemble, comme dans l'immeuble, comme dans le bus. Je claironnais qu'elle était mon poteau, pourtant j'éprouvais de drôles et nouvelles sensations. Je ne voulais pas encore y prêter attention!
Les récréations étaient l'occasion de reformer notre bande, et même, si par la force des choses, Rachid, Marco et David se faisaient d'autres copains, il y avait entre nous cinq, un lien indéfectible, c'était sûr!
Quelques cours de musique et de travaux manuels plus tard, notre première année de collège s'était écoulée.
Pour la rentrée de l'année de cinquième, septembre était exceptionnellement doux et il me semblât la voir pour la première fois. Je l'attendais au pied de notre immeuble, quant elle parût; ses cheveux mi-longs et frisés étaient lâchés sur ses épaules, je ne les avais même pas vu pousser cet été! Elle portait une jupe et un haut à bretelles noirs, un ensemble d'Exopotamie, des sandales fuchsia lacées à la cheville, avec une sorte de marguerite sur le dessus du pied; le tissu légèrement transparent offrait à mes yeux son corps en ombre chinoise. Elle se mît à descendre les marches, tout en me regardant, même son regard était changé. A cet instant je me suis dit que le seul bonheur que je voulais laisser aux autres, c'était de la regarder, rien d'autre.
Nous ne nous sommes pas assis dans le fond du bus, mais sur une banquette seuls, je n'arrivais pas à faire autre chose que la dévisager; si ça n'avait pas été Sabrina, la situation aurait pu paraître bizarre, limite glauque. Ses yeux noirs brillaient sous sa frange, j'étais tétanisé, sans aucun courage, il a fallût une intervention de l'eau-de-là pour faire démarrer l'histoire. Sous la forme d'un nid de poule dans la chaussée qui a littéralement projeté mon visage sur le sien. La rencontre de nos nez fût un peu douloureuse, cependant, dans un acte inné, nos têtes se penchèrent inversement l'une de l'autre et nos bouches se touchèrent. Machinalement, j'avais saisi sa main depuis cinq minutes et j'ai senti à cet instant qu'elle serrait plus fort; moi je goûtais ses lèvres, elles étaient douces et sentaient la fraise. Cela n'avait pas duré plus de vingt secondes, et nous n'avions toujours pas dit un seul mot, ni elle, ni moi. Une tape sur ma tête et un grand éclat de rire bêta me sortirent de ma béatitude; c'était David, le menton posé entre les deux dossiers des fauteuils, qui faisait le pitre. J'étais gêné, comme pris la main dans le pot de confiture; je ne trouvai que des imbécillités à lui envoyer au visage : « tu fais chier David, on peut plus se dire un truc dans cette bande ! ». La tête de David disparût d'entre les fauteuils dans un grand éclat de rire. Je compris ce jour là, que je devais être le dernier au courant de mes propres sentiments. Elle me connaissait si bien, que d'un regard, elle complétait mes pensées, j'en savais tellement d'elle, que d'un regard, je lisais les siennes.
Nous étions trop jeunes pour aller plus loin que de simples bisous et des doigts entrecroisés, et cela ne changeait guère nos rapports, en fait pas assez pour mettre en péril la bande.
Ainsi, il était de notoriété que nous sortions ensemble.
Cette année là, j'éprouvais de nombreux et perturbants sentiments; je me demandais quasiment à chaque instant de la journée, à quoi pouvait penser Sabrina, ce que je pourrais faire pour elle, de quoi elle pouvait avoir envie. Il y avait quelqu'un d'autre en dedans de moi!
C'est en quatrième que David et Marco quittèrent le circuit classique de la scolarité pour entrer en classes aménagées.
Ce fût un petit déchirement de notre bande; car dans ces classes, le système scientifique et élitiste abandonnait les affreux, les turbulents en fait tous les élèves dont il ne savait que faire. On y trouvait le haut du panier des cas sociaux, l'enseignement était ralenti, aménagé et en règle générale, on ne revenait jamais de ces sections.
Pour Marco, je n'étais pas vraiment surpris, mais David... J'en avais mal au ventre. Lui, semblait moins s'inquiéter que moi.
Ils retrouvèrent quelques éléments d'autres bandes de la cité et même d'autres cités voisines. Nous nous étions croisés quelques fois, le plus souvent nous nous regardions de haut, étalant nos muscles respectifs comme une force de dissuasion, nous jouions notre propre West side story.
Cette classe, était aussi la dernière fréquentée par mon frère quelques années auparavant!
Ce qui s'avéra être une chance pour moi, fût aussi ce qui m'éloignât des gens les plus proches de moi jusqu'ici. Mon arrivée au collège, fût une source d'intégration, de nouveauté; je n'ai pas cherché à reconstruire mon univers, recherchant mes semblables, j'ai plutôt aspiré d'autres influences.
Norbert, à présent, avait terminé son CAP, il était engagé par le patron qui l'avait pris en stage. Il donnait à notre mère la quasi totalité de son salaire, cela arrangeait bien nos affaires. A cette époque, il commença une vie nocturne très active, notre mère pensait à une fille, moi je ne pensais rien, ou plutôt, je ne pensais qu'à moi, en fait qu'à Sabrina, ce qui était exactement la même chose, je ne nous voyais plus qu'en entité unique.
En réalité, la majorité des sorties nocturnes de Norbert, l'amenait aux abords du port; il retrouvait des gars, qui remplissaient le coffre de sa voiture de marchandises; et lui les amenait à son patron, au garage. Il était ni plus ni moins que transporteur, dans un recel d'objet volés aux déchargements de bateaux ou de camions. Des cigarettes, des montres, de l'alcool, des équipements audio et vidéo, tout ce qui avait une forte valeur marchande et une chance de revente dans la rue proche du 100%. Le réseau était bien en place, il n'était qu'un exécutant, mais ça pouvait mener directement au tribunal. Il ne s'agissait plus de casser des boites à lettres ou d'uriner contre la porte d'un voisin qu'on aimait pas.
Dans les villes portuaires, ce jeu du chat et des souris est un grand classique du genre; il laisse sur le carreau, les petits, ceux qui travaillent dans la rue. Mais les organisateurs, eux, sont bien trop prudents, il n'existe pas de lien avec leur piétaille qu'on arrête, ou du moins aucune preuve établissant ce lien.
Bien entendu, une nuit, Norbert fût pris au moment où il embarquait, dans son coffre, quelques magnétoscopes. Menottes aux poignets, il fût conduit dans les bureaux de la BRB et interrogé plusieurs heures. La filière était sous surveillance depuis quelques temps déjà, les flics n'avaient pas vraiment besoin de renseignements, mais plutôt de confirmations. Simultanément, le patron du garage fût, lui aussi, arrêté cette nuit là; restait le maillon juste au-dessus, plus gros gibier, sans être le fermoir de la chaîne. Cette personne venait les lendemains des opérations, prendre les dernières nouvelles et surtout le détail complet du butin à revendre. Au bas de la petite rue où se trouvait le garage, il y avait un bar, bien nommé : bar des routiers. Ainsi, devant un café, on faisait les comptes ! Le patron du garage avait été amené pour une confirmation visuelle de son contact, une fois réalisée à travers la vitrine, deux flics en civil entrèrent dans le bar. Brassards oranges au bras, ils se dirigèrent sans hésitation vers l'individu désigné; l'homme ne chercha même pas à s'enfuir, pour éviter toute bavure, il posa sagement ses deux mains sur le comptoir, le reste de l'assistance était immobile, interloquée. Il sortait, encadré des deux flics, quand il s'adressa au patron derrière le comptoir : « Fernand, met le café sur ma note, je vais pas tarder à venir le régler », le tout avec un large sourire.
Le verdict, pour mon frère, tomba et ce fût un choc pour moi; deux ans fermes de prison. Je n'avais rien vu, rien compris, j'avais été incapable de l'aider, de le sortir de cet engrenage. Sabrina me rassurait en me disant que c'était lui, le grand frère. Par bonheur, ou intelligence, il n'avait jamais rien amené à notre appartement, nous ne fûmes donc pas inquiétés, ma mère et moi. Du moins du point de vue judiciaire, car notre mère recommençât à pleurer chaque nuit. Elle cherchât à avertir notre père, mais il n'y eut aucune réponse de sa part, rien, même pas pour Norbert.

 Je crie que je
ne crois en rien, et que tout est absurde, mais je crois en mon cri.
Je crie que je
ne crois en rien, et que tout est absurde, mais je crois en mon cri.